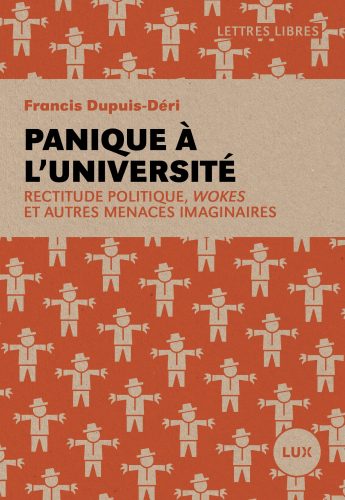Collections : Les événements polémiques qui sont reliés aux « wokes » ont maintes fois été relayés dans les médias québécois. Est-ce qu’à vos yeux, cela est une forme de propagande réactionnaire ?
Francis Dupuis- Déri : C’est réactionnaire dans le vrai sens politique du terme, c’est-à-dire que les polémistes affirment que les études féministes et sur le racisme, entre autres, ont pris le contrôle de l’Université et l’ont détruite et se répandent dans la société pour tout ravager. Les polémistes sont donc en réaction, adoptant une posture typique de l’histoire longue, où s’opposent trois éthos politiques : les progressistes qui espèrent que la situation sera meilleure dans l’avenir, les conservateurs qui pensent devoir protéger la société telle qu’elle est et les réactionnaires qui pensent qu’il faut revenir dans un passé mythifié. Pour nos polémistes, il faut assurément revenir dans le monde d’avant, car les féministes et les antiracistes vont « trop loin » (d’où l’expression, par exemple, de « néoféministes » pour les discréditer). Mais bon, dans le livre je montre qu’on nous répète ça depuis au moins les années 1980, avec par exemple L’âme désarmée, d’Allan Bloom, qui comparait ses collègues féministes de l’Université de Chicago à des Khmers rouges, rien de moins !
Afin de voir plus clairement ce qui se déroule dans les universités, vous avez décidé de faire un survol de l’histoire de cette institution pour démontrer que ce lieu a toujours été un endroit où une certaine tension était nécessaire afin de faire évoluer la société. Avez-vous des exemples marquants ?
En fait, l’histoire de l’Université est paradoxale, car il s’agit d’une des plus vieilles institutions d’Europe et la vie s’y déroule de manière très calme, souvent routinière, parfois même ennuyante, mais il y a pourtant aussi une tradition de chahut et de conflits idéologiques politiques, religieux et culturels, entre autres. Certes très rares et ne survenant que dans quelques campus seulement, ces conflits – chahuts, appels au boycott, occupations, grèves – reflètent les luttes sociales qui traversent la société. Dès les premières années de l’Université en Europe au XIIIe siècle, il y a eu des grèves étudiantes contre des professeurs, mais aussi contre le prix des loyers. Dans le livre, je rappelle aussi que des étudiants catholiques et d’extrême droite ont chahuté des amphithéâtres de professeurs socialistes, et que des collègues féministes à l’UQAM ont reçu des menaces de mort (moi aussi, d’ailleurs) et qu’il y a eu procès et jugements de culpabilité. Mais les forces progressistes sont aussi actives sur certains campus. Les féministes et les antiracistes, entre autres, ont poussé depuis les années 1960-70 pour le développement d’un enseignement et de recherches sur des sujets les préoccupant, et c’est très bien ! Ce développement est très lent, mais il représente un important élargissement de la liberté académique dans l’enseignement et la recherche, et il peut avoir des effets positifs dans la société.
Dans votre livre, vous présentez la situation qui se déroule aux États-Unis, en France, au Canada et au Québec. Pourquoi est-il nécessaire de faire cette distinction ?
Je suis passé dans le réseau universitaire de ces trois pays et je crois aussi que les comparer permet de bien identifier des similarités troublantes, par exemple des attaques contre les études féministes et sur le racisme quel que soit leur développement réel dans les universités, soit bien plus avancé aux États-Unis, mais presque pas du tout en France. Qu’importe, la virulence est la même. La comparaison permet aussi d’identifier des particularités : en France, les attaques se doublent d’un rappel narcissique que la France serait la patrie de la civilisation universaliste menacée par le communautarisme puritain des États-Unis, alors qu’au Québec les attaques se doublent d’une défense du monoculturalisme menacé, nous dit-on, par le multiculturalisme d’Ottawa et des fédéralistes.
Les enjeux sont-ils les mêmes en Europe francophone et au Québec ?
L’enjeu est quelque peu différent au Québec, en comparaison aux États-Unis et en France, où les forces d’extrême droite sont bien plus développées, que ce soit dans des partis politiques (40 % des suffrages pour l’extrême droite aux élections présidentielles françaises de 2022), mais aussi dans des groupes militants comme les Proud Boys et Atomwaffen Division, aux États-Unis, ou la Cocarde et les Zouaves, en France. Ces forces reprennent la même rhétorique outrancière contre les féministes et les antiracistes. Heureusement, nous restons relativement préservés d’une telle dérive au Québec. On voit donc bien que l’expression « polarisation politique » est trompeuse. Car la droite se tasse de plus en plus vers une extrême droite en développement, alors que la gauche se tasse vers le centre et l’extrême gauche est exsangue. Ce qu’on nous présente comme l’extrémisme de l’extrême gauche n’est que le renversement de quelques statues, la féminisation du langage, des traumavertissements avant de parler de sujets délicats. Le Black Panther Party, par exemple, était anticapitaliste et prônait la lutte armée contre la police. En comparaison, Black Lives Matter apparaît comme pas du tout radical, alors que des groupes d’extrême droite comme les Proud Boys paradent les armes à la main et participent à l’assaut du Capitole où des policiers ont perdu la vie. Parler de « polarisation politique » dans ce contexte embrouille les esprits et n’explique rien.