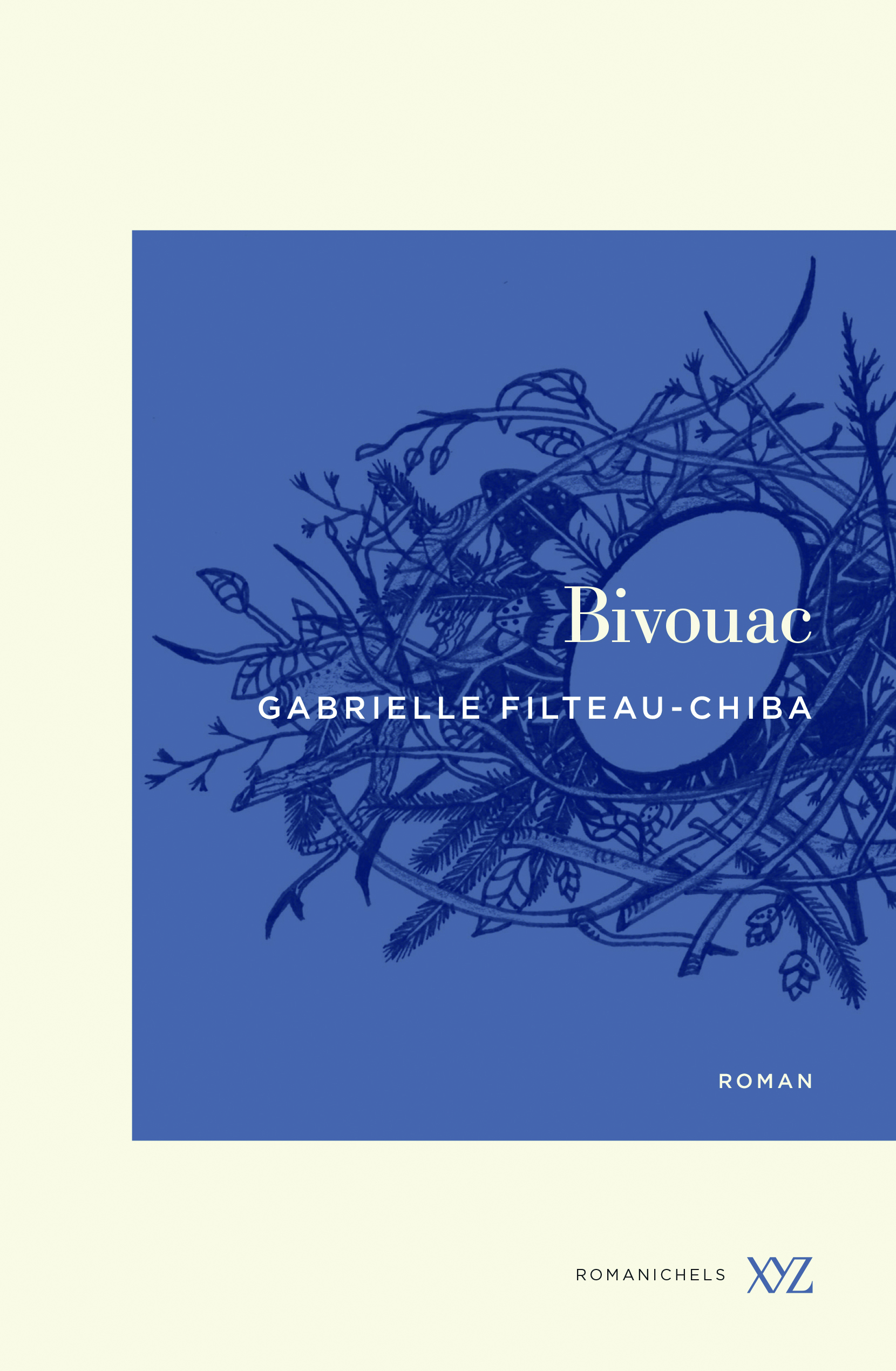La principale intéressée en parle comme d’un cri du cœur. « Chaque fois que je vis une frustration viscérale liée à l’environnement, ça me donne envie de l’écrire pour le plus grand nombre. Auparavant, j’écrivais pour le plaisir sans penser être publiée, mais quand j’ai eu l’impression d’être l’ambassadrice d’une cause, je me suis dit qu’il fallait que ça aille plus loin. »
Tout a commencé avec la menace imminente du projet Énergie Est et les séances de mobilisation dans les cuisines de Kamouraska où elle demeure. « À l’époque où je vivais comme une ermite, mes premiers amis ont été les écologistes sur le terrain. J’ai découvert une contre-culture qui œuvrait dans l’ombre pour le bien. Je trouvais ça fascinant de voir ces humains aimer la nature au point de faire des coups d’éclat qui pourraient les mettre dans le trouble. »
Peu après, le piège de braconnier dans lequel sa chienne a été capturée l’a poussée à ressortir sa plume. « C’est la première scène de Sauvagines que j’ai écrite. Au départ, je voulais l’envoyer au journal local pour montrer ce qui se passe dans nos forêts à mes concitoyens, qui ont aussi perdu des chiens et des chats au cours des dernières années sans savoir qu’ils étaient peut-être en train d’agoniser dans les pièges installés autour de nos maisons. »
À la dernière minute, elle a demandé au journal de ne rien publier pour éviter de se mettre la communauté à dos. « Je ne voulais pas être perçue comme la Montréalaise qui débarque avec ses gros sabots. Ayant été conseillère municipale au village, j’ai aussi constaté que l’aspect environnemental n’était pas bien vu. » Elle n’a pas baissé les bras pour autant. « J’ai mené une enquête pour savoir qui était ce fou qui posait des pièges autour de ma maison. Je ne pensais pas écrire un roman. »
Elle constate néanmoins que la protection du territoire est la pierre angulaire de sa démarche artistique. « C’est le fil conducteur de mon œuvre. » Ses livres vont du roman à la poésie, sans flirter avec le documentaire. « Quand on essaie de convaincre en montrant des images très choquantes, ça nous fait mal, mais je pense qu’éblouir est encore plus puissant que de choquer. La beauté a un pouvoir de guérison. Je veux que les lecteurs se retrouvent dans un lieu encore préservé qui donne l’illusion que tout ça est encore existant. »
L’équipe des Éditions XYZ est persuadée que la voix de Gabrielle Filteau-Chiba peut changer les choses. « Elle participe à mobiliser et à réenchanter notre rapport au territoire, explique la directrice littéraire Myriam Caron-Belzile. Plusieurs jeunes la lisent dans les cégeps et je crois qu’ils peuvent se sentir autorisés à clamer les mêmes revendications et à en faire de l’art. Je trouve ça beau que la militance et l’art puissent se rencontrer. »
La mise au monde des convictions
Quand on questionne l’autrice sur la naissance de ses préoccupations pour la nature, elle évoque ses origines mi-québécoises, mi-allemandes. « Petite, j’allais souvent en Allemagne avec mon père et je voyais qu’un autre monde était possible. Là-bas, l’écologie était déjà à l’avant- plan il y a 30 ans. »
Elle se souvient de cabines téléphoniques avec des panneaux solaires, de nombreux écoliers qui se rendent à l’école en vélo et des traverses de tortues et de grenouilles sur la route. « Je n’avais jamais vu un passage faunique au Canada, à part sur l’autoroute pour que les automobilistes ralentissent pour ne pas frapper des chevreuils. Je me souviens aussi de me baigner en me faisant bécoter le corps par les poissons ou en voyant des cygnes nager tout près sans avoir peur des humains. J’étais dans une nature préservée comme je n’en avais pas vu au Québec et ça m’a émue. »
C’est peut-être en raison de cet éveil hâtif à la nécessité de poser des gestes pour préserver la nature qu’elle se démarque aujourd’hui des autres autrices québécoises puisant leur encre dans le territoire. « À l’international, la place du territoire dans la littérature québécoise est ce qui revient toujours. C’est dans notre ADN. Notre attachement est très fort. Cela dit, mes personnages ne font pas juste évoluer dans le territoire, ils posent des gestes. »
En effet, son éditrice sent une volonté de susciter une adhésion à sa militance en donnant accès au ressenti de personnes affectées par la destruction du territoire, que ce soit une mère inquiétée par ce qui attend son enfant ou une garde-chasse confrontée aux limites que la loi lui impose comme possibilités de protection du territoire. « Gabrielle nous montre les écueils et le ressenti humain de ces écueils, dit Myriam Caron-Belzile. C’est pour ça qu’elle a choisi la fiction plutôt que l’essai, car la fiction nous permet d’incarner. Une des beautés de la littérature, c’est de développer via l’empathie pour les personnages une identification à une cause, à un enjeu ou à une réalité. En voyant quelqu’un se battre contre les menaces, on est amenés à se sentir conscientisés. »
« Plusieurs jeunes lisent Gabrielle dans les cégeps et je crois qu’ils peuvent se sentir autorisés à clamer les mêmes revendications et à en faire de l’art. Je trouve ça beau que la militance et l’art puissent se rencontrer. »
Myriam Caron-Belzile
« Avant, je boudais la société. Je vivais dans ma cabane et ça me suffisait de m’extraire de ce qui me dérange et de me dire que les choses vont se passer comme je le veux dans mon petit royaume. »
Gabrielle Filteau-Chiba
Pourtant, l’écrivaine a longtemps été en dehors du monde. « Avant, je boudais la société. Je vivais dans ma cabane et ça me suffisait de m’extraire de ce qui me dérange et de me dire que les choses vont se passer comme je le veux dans mon petit royaume. Par contre, quand est arrivé l’incident avec ma chienne, je me suis rendu compte que j’avais peut-être le devoir de conscientiser mes voisins, les gens du village et de la région. »
Ce n’est pas pour rien que le collectif est à l’avant-plan dans Bivouac. « Je voulais raconter ma réconciliation avec les humains, car ça prend la force du nombre pour gagner ces combats. Au début, quand je militais contre le pipeline à Kamouraska, on était 4 ou 5 autour de la table, mais quelques semaines plus tard, nous étions 250 sur ma terre. » À force de réfléchir au monde de demain avec eux, elle a tissé des liens très forts. « J’ai trouvé ça fascinant de rencontrer ces humains-là. Ils sont devenus mes personnages de romans. »
Écoféminisme littéraire
Quiconque met son nez dans les livres de Filteau-Chiba prend conscience de la place centrale qu’occupent les personnages féminins. « Quand on regarde les écrivains du nature writing, ce ne sont que des hommes, comme Sylvain Tesson et Henry David-Thoreau. J’avais peu d’exemples féminins. Pourtant, j’aurais aimé lire c’est quoi être une femme en forêt. Comment tu vis avec le fait d’être menstruée et entourée d’ours ? En général, on est moins fortes physiquement, alors le défi est plus grand pour une femme. »
N’allez toutefois pas croire que l’écrivaine prend ses personnages féminins en pitié. Surtout pas en cette époque teintée par les dénonciations du mouvement #MeToo. « Personnellement et dans mon entourage, toutes les femmes que je connais ont vécu des agressions, des incestes ou des viols. Moi, je crois qu’on ne doit pas être des victimes toute notre vie. Il faut transcender cette souffrance-là. »
Elle le fait d’abord en écrivant : « Quand la victime se sauve elle-même, l’histoire est encore plus forte. » Et dans la vie quotidienne : « Quoi de mieux que l’action directe ? J’ai l’impression que lorsque je prends soin de la nature, je prends soin de mon corps. L’instinct maternel, ça passe par un respect du vivant et des gestes au quotidien. »
Pour Myriam Caron-Belzile, il est facile de sentir l’urgence du soin et de la protection dans les propos de Filteau-Chiba. « En la lisant, il y a une évidence. On partage tous cette espèce d’anxiété sur ce qui nous attend. Dans sa façon de parler, on ressent une possibilité de trouver une emprise dans l’espoir et à échelle humaine. » Le contraire sera dommageable à ses yeux. « Si on parle uniquement de menace, d’inquiétudes et de l’ampleur du défi, on peut se retrouver paralysés dans l’inaction, ce qui est dangereux. Le propos de Gabrielle nous donne à ressentir la pertinence de l’action individuelle, de l’affiliation et de la sororité. »
Il y a, selon l’autrice, quelque chose de féminin dans la protection du territoire. « Je trouve ça beau l’archétype de la femme forte qui, sans arme, vient mettre une fleur dans un canon. Ces rituels symboliques sont plus forts qu’une armée. Le but est de conscientiser. Ça nous ramène à la beauté de la lutte. »
Publiés depuis un an en France, ses livres font écho à des luttes communes partout sur la planète. « Mes deux maisons d’édition françaises me disent qu’elles avaient vraiment faim pour ce type de livres qu’elles n’avaient jamais publiés. Plusieurs lecteurs et lectrices me parlent aussi de leur projet de conservation. Tous les matins, je commence avec un ou deux messages de gens qui me partagent leurs projets. Ça me nourrit. »
Dans les différents événements littéraires, Myriam Caron-Belzile voit bien comment son propos résonne fort. « Quand j’en parle en salon du livre, je vois les yeux s’agrandir. Il y a beaucoup de gens qui tournent le dos à l’urbanité, à l’hyperconsumérisme et à l’hyperconnexion pour aller s’implanter dans la nature. Son premier roman, Encabanée, continue de rejoindre de nouveaux lecteurs et lectrices en grand nombre chaque année. » Et ce, sans être une lecture déconnectée du réel. « Le personnage ne nous montre pas une version idéalisée du retour à la nature. C’est difficile ce qu’elle va vivre. Sa peur de mourir devient obsédante. Il ne faut pas mythifier la connexion à la nature. On doit être honnête. »
L’autrice voit ses livres comme des outils d’éveil, tant pour les jeunes que les personnes âgées. « Tous mes personnages sont des marginaux qui réussissent à faire société autour de ce bel enjeu. » Voilà un beau défi à une époque d’extrême polarisation. « Avant, on était souverainistes ou non, on prenait pour telle ou telle équipe de hockey, mais il n’y avait pas schismes aussi profonds que ce qu’on vit en ce moment. Selon moi, la nature a ce pouvoir de nous fédérer.
« Je trouve ça beau l’archétype de la femme forte qui, sans arme, vient mettre une fleur dans un canon. Ces rituels symboliques sont plus forts qu’une armée. Le but est de conscientiser. Ça nous ramène à la beauté de la lutte. »
Gabrielle Filteau-Chiba
J’aimerais qu’on se réconcilie avec les Premières Nations. Ce ne sera pas facile. Il y a un travail énorme à faire, mais je vois la nature comme un terrain sur lequel pourraient se rejoindre allochtones et autochtones. »
Ne comptez pas sur elle pour être totalement découragée en lisant les rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et en apprenant les récentes décisions des gouvernements en matière d’environnement. « Ça me donne encore plus envie de travailler. On n’a pas le droit d’abandonner. » Elle affirme toutefois que sa réponse était différente il y a six ans. « J’étais plus défaitiste à l’époque et ça paraît dans mes livres. Encabanée est plus sombre que Bivouac. Mais le fait de devenir mère, ça me rappelle qu’on ne fait pas ce travail dans le court terme, mais pour les futures générations. »
Elle n’hésite d’ailleurs pas à regarder dans le passé pour améliorer l’avenir. « Ce qui m’anime de plus en plus, ce sont les arbres anciens. J’essaie de les trouver pour protéger ces îlots qui regorgent de toutes sortes de remèdes médicinaux et de molécules qu’on ne comprend pas aujourd’hui. »
À ses yeux, la nature est immensément mystérieuse et on devrait la vénérer comme une divinité. « Je rêve d’un Québec avec des sentiers pédestres menant vers les arbres anciens qui restent. Un peu comme un changement de paradigme où l’on verrait tout le monde retourner vers ses personnes âgées. »