Collections : Quelle est la différence entre Grégoire Courtois et votre pseudonyme, Tristan Saule ? Ont-ils une persona d’auteur, un style, des intérêts ou des buts différents ?
Grégoire Courtois : Tristan Saule est un nom, et c’est aussi un projet littéraire. La différence entre les deux œuvres tient principalement aux procédés d’écriture employés. Tristan Saule produit des romans à un rythme régulier, ce qui impose d’aller à l’essentiel, tant au niveau de la construction que du style. A contrario, ce que j’ai publié et que je continuerai à publier sous mon vrai nom autorise plus de recherche, de maturation, de reprise à zéro. Je m’aperçois que j’aime également ces deux manières d’écrire.
Quelle sera la fonction de la place carrée, dont le marché dominical et les flux de passants font l’objet de plusieurs descriptions bien ficelées dans le roman, dans la série Chroniques de la place carrée, que vous inaugurez avec Mathilde ne dit rien ?
G.C. : Ce lieu est le centre du monde de mes personnages. Littéralement. C’est leur monde. Pour le décrire, je me suis inspiré d’un quartier situé à quelques centaines de mètres de là où j’habite. Ici, beaucoup d’habitants ne vont jamais au centre-ville. Toute leur vie s’organise dans ce périmètre. J’ai aussi choisi cet endroit à cause de sa forme, une résidence en U qui cerne une place où tout se passe. Comme au théâtre, il manque un quatrième mur. Le quatrième mur, c’est le lecteur.
Comment se développeront les autres tomes de la série ?
G.C. : L’idée était de braquer le projecteur sur un ou deux personnages par roman. Mathilde est le personnage central du premier volet. Si on la recroise par la suite, ça ne sera que furtivement. De la même manière, certains personnages secondaires deviendront les protagonistes d’un prochain roman. Chaque tome se déroulera un an après celui qui le précède. Mon ambition, c’est de raconter, année après année, la vie des habitants de ce modeste quartier français dont je suppose et crains qu’il devra faire face à de nombreux problèmes dans la décennie qui vient.
Qu’est-ce qui vous a incité à aborder des thématiques sociales, intrinsèquement liées à votre intrigue ?
G.C. : C’est difficile à dire. Peut-être que je me suis dit qu’à quarante ans passés, il était temps de sortir de mon confortable cocon, de me confronter au monde, d’apprendre de lui, tout en témoignant. Pour ça, je savais qu’il n’était pas nécessaire de m’envoler vers un pays lointain. Il suffisait de faire trois cents mètres à pied. C’est ce que j’ai fait.
Mathilde a l’habitude de calculer chacun de ses gestes en respectant des délais de huit minutes. Comment cette conception angoissée du temps définit-elle le personnage, voire la construction du roman ?
G.C. : Mathilde vit dans la peur que tout s’écroule, à chaque instant. C’est une réaction post-traumatique fréquente. Il m’a paru intéressant de lier la terreur intime de cette femme banale à un mouvement cosmique, qui la dépasse, à tous les niveaux. De plus, cette idée est aussi un reflet du livre, lui-même construit comme une succession de comptes à rebours.
Si vous deviez nommer trois auteurs qui vous ont nourris, qui seraient-ils et pourquoi ?
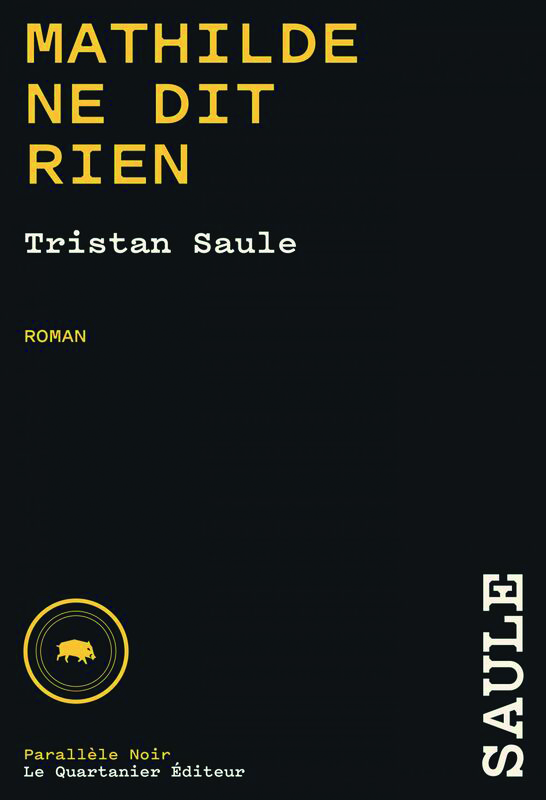
 « Mathilde vit dans la peur que tout s’écroule, à chaque instant. C’est une réaction post-traumatique fréquente. Il m’a paru intéressant de lier la terreur intime de cette femme banale à un mouvement cosmique, qui la dépasse, à tous les niveaux. »
« Mathilde vit dans la peur que tout s’écroule, à chaque instant. C’est une réaction post-traumatique fréquente. Il m’a paru intéressant de lier la terreur intime de cette femme banale à un mouvement cosmique, qui la dépasse, à tous les niveaux. »