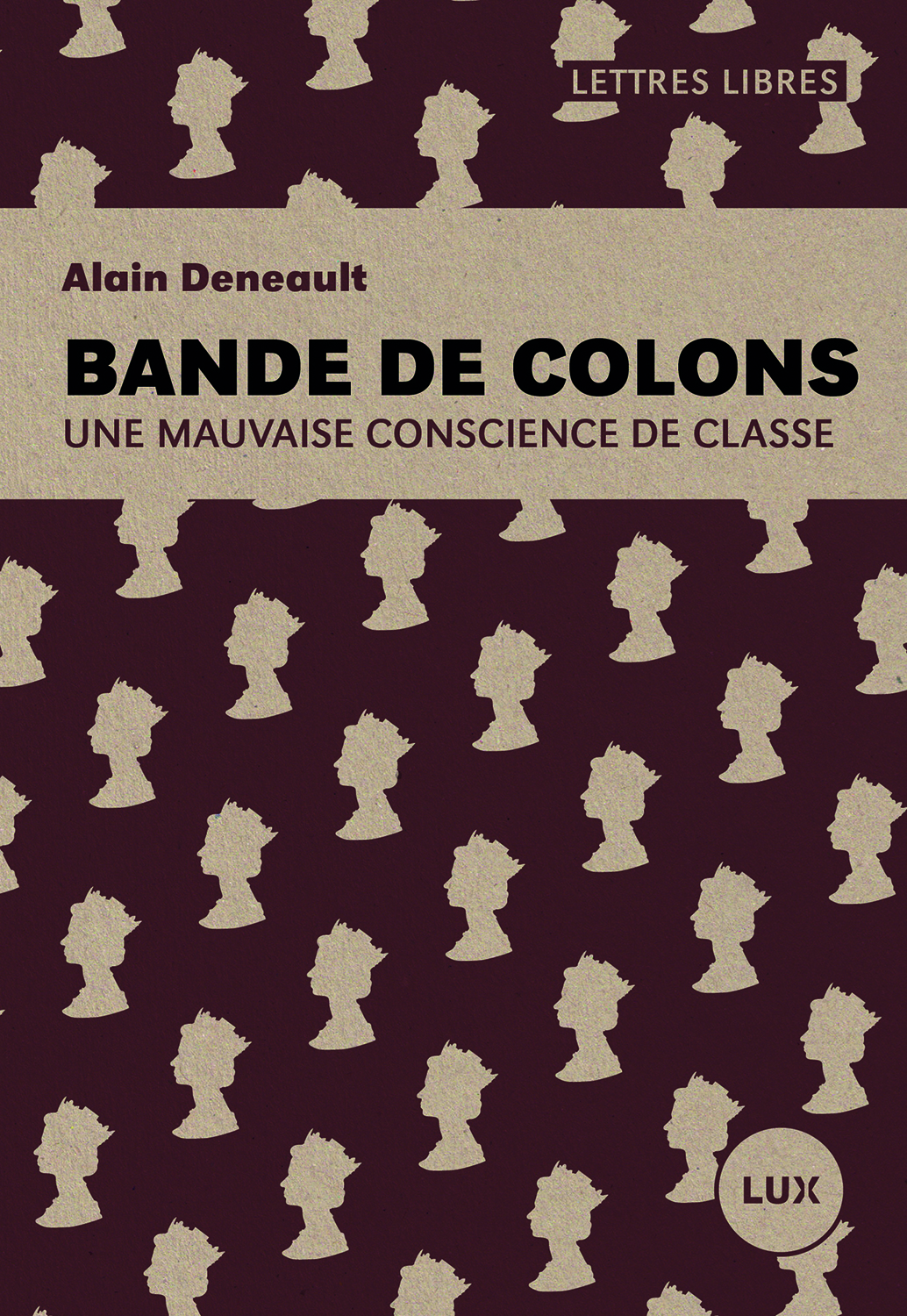Entrevues et portraits
Alain Deneault
Une mauvaise conscience de classe
Docteur en philosophie de l’Université Paris VIII, Alain Deneault poursuit une double carrière de professeur dans le milieu universitaire et d’auteur. Reconnu pour ses prises de position politiques et sa plume acérée, il est l’un des essayistes québécois les plus en vue à l’heure actuelle. À l’automne 2020, il a publié Bande de colons, un ouvrage indispensable qui propose une véritable relecture de l’histoire de la province. L’équipe de Collections a eu l’immense privilège de s’entretenir avec le philosophe, qui bénéficie présentement d’une visibilité de plus en plus grande en Europe.
Collections : Que représente pour vous l’essai ? Quelles possibilités ce genre offre-t-il ?
Alain Deneault : L’essai n’est assimilable ni au genre de l’écrit scientifique de pointe ni à une entreprise de vulgarisation, auxquels on le confond trop souvent. Il se situe à un carrefour démocratique où sont soulevés des questions de sens et des enjeux particuliers dans lesquels tout esprit de bonne volonté peut se retrouver. Quant aux questions qu’il soulève, il ne s’adresse pas plus à l’initié qu’au profane. Un Jérôme Monod peut écrire Le hasard et la nécessité (1970) sur les thèmes des sciences afin de stimuler autant la pensée de ses collègues que celle du citoyen qui n’est pas particulièrement compétent en sciences, par exemple.
Collections : Dans votre plus récent ouvrage, Bande de colons, vous complétez la dyade « colonisateur/colonisé », esquissée par Albert Memmi, par un troisième terme, le colon. Qui est-il au juste ? Comment le définiriez-vous par rapport au colonisateur et au colonisé ?
A.D. : Le colon n’est ni le colonisateur, qui façonne le projet colonial et en bénéficie sur un mode capitaliste, ni le colonisé, qui se trouve mis hors-jeu en fonction de distinctions civilisationnelles et raciales. Mais Albert Memmi n’a pas du tout brossé un Portrait du colon pour deux raisons. D’abord, son approche caractérologique l’amène à adopter des critères psychologiques qui ne favorisent pas une distinction entre, disons, le chef d’entreprise colonisateur qui exploite le caoutchouc ou le cacao en Afrique et le petit agent salarié qui occupe une simple fonction administrative dans la colonie en profitant des avantages que celle-ci lui réserve : occupation de villas, présence de domestiques, sentiment de supériorité selon des conceptions racistes…
« Le colon n’est ni le colonisateur, qui façonne le projet colonial et en bénéficie sur un mode capitaliste, ni le colonisé, qui se trouve mis hors-jeu en fonction de distinctions civilisationnelles et raciales. »
Alain Deneault
Ensuite, la France, contrairement au Royaume-Uni, n’a pas souhaité développer une colonie de peuplement. Elle n’envoie donc pas massivement de colons dans les pays chauds se livrer au dur labeur de l’exploitation, alors qu’au Canada, les colons descendants d’Europe deviendront rapidement majoritaires, à la faveur d’un génocide à petit feu commis envers les peuples d’origine. Donc, Memmi n’a connu comme « colons », dans sa Tunisie coloniale, que des petits cadres mesquins et médiocres qui s’échinaient par tous les moyens à se donner des allures de colonisateurs, même si, lorsqu’ils retournaient dans l’Hexagone, durant leurs vacances par exemple, ils se redécouvraient dans une position tout à fait banale de citoyens de la classe moyenne, sans avantages particuliers. Or, au Canada, et c’est sans doute le cas aussi en Algérie, en Afrique du Sud ou en Australie – et en Israël a fortiori, là où le colon se désigne nommément tel –, le colon ne peut pas ne pas être pensé en tant que membre d’une catégorie à part.
Collections : À la lecture de Bande de colons, on sent que vous avez énormément lu des essais théoriques et critiques sur le phénomène de la décolonisation, à commencer par ceux d’Albert Memmi. Comment vous situez-vous par rapport aux écrits de cet auteur ? Y a-t-il d’autres penseurs ou philosophes qui vous ont influencé ? Si oui, lesquels ? Et de quelles façons ont-ils enrichi votre travail ?
A.D. : Après avoir pris conscience de l’approche psychologique et strictement tunisienne des essais de Memmi, j’ai moins cherché à approfondir son œuvre elle-même qu’à comprendre comment ses spécificités ont pu nuire à la conscience politique québécoise, lorsque des intellectuels d’ici ont, dans les années 1960 et 1970, assimilé ses écrits sans suffisamment les adapter aux particularités de notre contexte. D’ailleurs, l’intéressé lui-même était embarrassé de voir des Canadiens français, comme on le disait alors, se réclamer de son travail pour se dire à leur tour « colonisés », alors qu’ils jouissaient souvent d’un niveau de vie, sur un plan matériel, bien supérieur à celui d’Européens. Ce malaise était parfois partagé par d’autres auteurs qu’on citait également au Québec pour plaider sa cause : Jean-Paul Sartre, Jacques Berque, Frantz Fanon… J’ai tenté de surmonter ledit malaise, en avançant l’hypothèse qu’il s’explique par une confusion dans les termes et une carence lexicale. L’inscription du terme « colon » permet de sortir de la dialectique stérile entre colonisateur et colonisé, issue de l’anglophonie et de la francophonie, de l’Angleterre et de la France, et elle révèle une perspective matérialiste, au sens où le colon appartient à une classe sociale de subordonnés légèrement et aléatoirement avantagés qui arrivent mal à se dire.
Collections : Le sous-titre de votre livre est Une mauvaise conscience de classe. Qu’entendez-vous par cette expression ?
A.D. : Le colon a beau, selon les circonstances, tenter de revendiquer les prestigieux attributs de la classe dominante des colonisateurs, ou encore essayer de se faire reconnaître parmi les colonisés du régime – strictes victimes du processus historique –, le jupon dépasse inexorablement, et c’est encore ce statut de colon qui lui revient. Mon essai cherche à identifier les différentes ruses de l’esprit par lesquelles la « classe moyenne » canadienne a cherché par tous les moyens à éviter de prendre conscience de ce statut de classe, car il suscite, cette fois sur un plan moral, une mauvaise conscience.
Collections : Est-il possible d’en finir avec la figure du colon, avec l’imaginaire colonial ? Existe-t-il des pistes de solutions ? Faut-il, comme vous le revendiquez dans votre livre, démanteler le Canada ?
A.D. : Le Canada a été et reste une entreprise de spoliation des matières premières qu’y ont exploitées des oligarques, tantôt sous la forme de sociétés à charte, tantôt sous la forme de la libre entreprise. Le nier condamne les idéologues et les sémanticiens du régime à monter en épingle des anecdotes à titre d’histoire : un insignifiant championnat de hockey en 1972, la figure d’un coureur unijambiste menant une campagne de financement contre le cancer, ou l’éternel symbole autoréférentiel d’une feuille d’érable se reproduisant jusqu’à la nausée. Les sujets de Sa Majesté que restent les Canadiens ne peuvent continuer d’occuper le territoire continental que sous le statut d’administrés. Toute velléité politique réelle, disons républicaine au sens du concept, suppose un éclatement de sa structure, laquelle ne s’explique que par le dessein d’exploitation massive de ses richesses. On ne peut vivre une expérience civique sur une échelle aussi vaste. Et rien, de toute façon, ne le justifie. D’autant plus que le changement de paradigme qui s’annonce au xxie siècle, à savoir les bouleversements climatiques, l’extinction massive des espèces, la crise énergétique et la pénurie de minerais, entraînerait une régionalisation radicale de l’activité politique ainsi que de l’intendance du travail et des richesses.