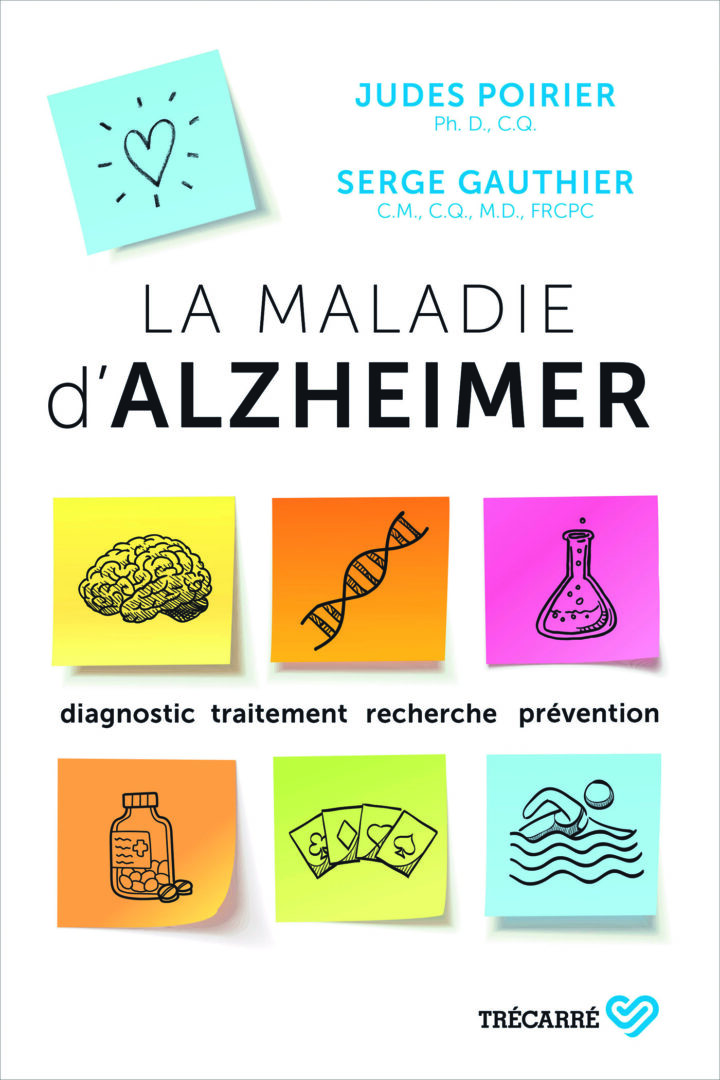Heureusement, après une vingtaine d’années marquées par des échecs parfois crève-cœur, la recherche a dernièrement fait des pas de géant. Bien qu’il n’existe toujours aucun traitement curatif pour guérir l’Alzheimer, des solutions pour repousser son apparition et soigner les symptômes existants émergent.
C’est dans ce contexte bouillonnant que les chercheurs québécois Judes Poirier et Serge Gauthier, reconnus internationalement pour leur apport à la recherche, ont refait équipe pour réviser leur ouvrage, paru il y a maintenant dix ans. Dans la nouvelle édition de La maladie d’Alzheimer. Diagnostic, traitement, recherche, prévention, les auteurs parlent évidemment de symptômes et de traitements, mais ils font également la part belle à la prévention et à l’accompagnement, en abordant notamment les décisions difficiles que doivent prendre le patient et son entourage aux différents stades de la maladie.
Collections : Qu’est-ce qui vous a convaincus de vous lancer dans un travail de réédition, dix ans après la première parution de votre livre ?
Judes Poirier :Depuis cinq ou sept ans, il y a eu des avancées majeures en ce qui concerne du diagnostic de la maladie d’Alzheimer et de la compréhension que nous avons de cette dernière, de sa mécanique. Avec l’imagerie cérébrale, on peut maintenant voir la maladie s’installer et évoluer avant même l’apparition des premiers symptômes ! Cette compréhension que nous avons désormais de l’Alzheimer nous permet de penser davantage à la prévention.
Serge Gauthier : On a d’ailleurs quelques nouvelles illustrations dans le livre en lien avec l’imagerie cérébrale. Mis à part ça, nous avons aussi eu la chance de recevoir beaucoup de commentaires des gens au fil des années, alors c’est un gros travail d’amour qui tient compte de la rétroaction que nous avons eue des familles.
Collections : Quelles nouvelles informations vous semblaient être les plus importantes à intégrer à cette nouvelle mouture ?
J.P. :Nous avons ajouté une section sur la détection et la compréhension de la maladie grâce à différents outils d’imagerie cérébrale, entre autres. Les tests mesurant les niveaux de biomarqueurs sanguins de la maladie d’Alzheimer n’existaient pas il y a trois ans à peine ! Les tests qui ont été développés dans les dernières années vont nous permettre de suivre en temps réel la progression de la maladie.
S.G. :On souhaitait aussi raffiner l’information à propos de chaque stade de la maladie, incluant le stade ou vous n’êtes « qu’à risque » de développer l’Alzheimer. Les progrès des cinq à huit dernières années ne sont pas liés à la découverte de nouveaux médicaments, mais plutôt à la découverte de stratégies de prévention primaire. Autrement dit, les facteurs de risque et les facteurs de protection sont aujourd’hui beaucoup mieux connus qu’avant.
Les tests mesurant les niveaux de biomarqueurs sanguins de la maladie d’Alzheimer n’existaient pas il y a trois ans à peine !
Judes Poirier
Collections : Vous nous apprenez dans votre livre que beaucoup d’initiatives pour trouver un traitement contre l’Alzheimer ont échoué ces dernières années. Qu’est-ce qui explique que les chercheurs se sont retrouvés dans un cul-de-sac ?
S.G. :Un des problèmes, c’est que la recherche ciblait seulement la protéine amyloïde [voir encadré en page 9 ], qui est une protéine que tout le monde accumule naturellement avec l’âge ! À 95 ans, on a tous de l’amyloïde, mais seulement la moitié des gens présentent des symptômes d’Alzheimer. Donc l’amyloïde, c’était la mauvaise cible de recherche pour l’Alzheimer en ce qui concerne les personnes âgées qui souffrent de la forme la plus courante de la maladie. Pour les gens plus jeunes qui souffrent d’Alzheimer familial, qui est une forme très rare de la maladie, il est possible que ce soit la bonne cible. Nous attendons d’ailleurs des résultats de recherche à ce sujet d’ici trois mois.
L’amyloïde, c’était la mauvaise cible de recherche pour l’Alzheimer en ce qui concerne les personnes âgées qui souffrent de la forme la plus courante de la maladie.
Serge Gauthier
J.P. :C’est aussi lié à la façon de procéder de l’industrie pharmaceutique. Dans ce cas-ci, les compagnies pharmaceutiques se sont acharnées sur une approche qui a échoué à plusieurs reprises depuis dix ans. Quand une compagnie décide de privilégier une certaine approche, les autres vont dans le même sens, parce qu’elles veulent être là le jour où on fera une découverte importante. C’est ce qui fait que les chercheurs vont à peu près tous se pencher sur la même chose simultanément. On obtient parfois de grands succès mais, à l’occasion, tout le monde échoue en même temps.
Collections : Vous mentionnez que l’Alzheimer coûte actuellement plus de 1000 milliards de dollars par année dans le monde, et que ce chiffre-là devrait doubler d’ici quelques années. Trouvez-vous qu’on en fait assez, globalement, pour endiguer la crise qui se dessine ?
S.G. :On n’en fait jamais assez, mais on doit aussi être réalistes. Tous ces gens [qui seront atteints d’Alzheimer] ne seront pas placés dans des centres d’accueil. Il faudra changer de stratégie. Dans certains pays, en Europe notamment, les gens restent chez eux. Pour que ce soit possible, il faut aider les membres de la famille de ces patients à demeurer à la maison pour s’occuper d’eux. Ça coûte moins cher de garder les gens à la maison, c’est aussi plus humain, mais il faut aider les proches à le faire. On va dans la bonne direction en ce sens, surtout au Québec, mais on peut faire encore plus, plus vite.
Collections : Et en ce qui concerne de la recherche, avez-vous accès à suffisamment de financement ?
S.G. :Pour la recherche, ça va bien. On est très chanceux tant au niveau provincial que fédéral. On collabore aussi avec l’Europe, les États-Unis et la Chine, depuis cinq ou six ans. Cela donnera rapidement des résultats concrets.
Comme avec le cancer, on aura peut-être des traitements par stade de maladie. C’est-à-dire qu’on essaiera d’abord un premier traitement. Si ce traitement échoue, on passera à la deuxième option, puis à une troisième en cas de nouvel échec.
Judes Poirier
J.P. :Nous sommes tout de même un peu à la traîne, au Canada. Les financements ont énormément augmenté aux États-Unis et ailleurs dans le monde ces dernières années. On investit des milliards de dollars dans la recherche sur l’Alzheimer ailleurs. Ici, les financements font du surplace depuis une dizaine d’années. Les coupes dans les financements accordés à la recherche sous le gouvernement de Stephen Harper ont fait très mal, et l’écart n’a pas été complètement rattrapé depuis. Le bon côté des choses, c’est que d’autres [pays] font cette recherche-là.
Collections : Depuis la parution de la première édition de votre livre, le Canada a adopté la loi sur l’aide médicale à mourir. On parle maintenant d’élargir la loi pour accorder l’accès aux personnes atteintes d’Alzheimer. Considérez-vous que c’est une grande avancée ?
S.G. :Moi j’y crois beaucoup. Ce sera un choix individuel, une option que les gens pourront prendre. Si vous avez des symptômes légers et que le diagnostic d’Alzheimer est confirmé par des tests biologiques, mais que vous en êtes au tout début de la maladie, vous pourrez choisir d’avoir recours à l’aide médicale à mourir au stade que vous aurez choisi d’avance.
J.P. :C’est une très bonne chose. À titre d’exemple, en Hollande, où on pratique l’aide médicale à mourir depuis plusieurs années, les cas de maladie d’Alzheimer ne constituent qu’environ 3 % de toutes les demandes d’aide médicale à mourir. Donc ce qu’on constate, c’est que lorsque les gens ont accès à l’aide médicale à mourir, ils ne choisissent pas nécessairement d’y avoir recours. Sur 6000 cas, ça représente à peu près 200 personnes, ce qui est très peu. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, chez les gens âgés de plus de 65 ans qui se suicident, environ 6 % souffrent d’Alzheimer.
Collections : Y a-t-il d’autres aspects de la maladie que vous aimeriez explorer dans une éventuelle troisième édition ?
S.G. :Honnêtement, il va se passer tellement de choses d’ici trois ans que je pense qu’on devra refaire une autre édition à ce moment ! [Rires] La prévention risque de devenir plus personnalisée. On aura davantage d’options, au-delà de l’exercice et de l’alimentation. Sinon, comme avec le cancer, on aura peut-être des traitements par stade de maladie. C’est-à-dire qu’on essaiera d’abord un premier traitement. Si ce traitement échoue, on passera à la deuxième option, puis à une troisième en cas de nouvel échec. Un des gros sujets d’actualité en ce moment, c’est de trouver comment bien combiner les traitements. C’est très rare qu’on traite le diabète ou la haute pression avec un seul médicament, alors on se demande actuellement comment combiner les traitements chez des gens qui souffrent d’Alzheimer.
J.P. :On parlera aussi probablement de nouveaux tests sanguins, qui pourront évaluer le risque qu’une personne développe l’Alzheimer. Ce sera une solution beaucoup plus économique que l’imagerie médicale. En ce moment, il en coûte environ 5000 $ pour passer un scan permettant d’évaluer si un patient est à haut risque de développer l’Alzheimer ou pas. C’est certain que les gouvernements sont réticents à investir autant d’argent. Sinon, on parlera effectivement de prévention. Éventuellement, on arrivera à reporter suffisamment l’apparition de la maladie pour parler pratiquement de guérison. Économiquement, ça coûte beaucoup moins cher de repousser l’apparition des symptômes que de laisser la maladie se déployer.
Collections : Vous êtes donc plutôt optimistes ?
S.G. :Ah, il faut l’être ! Si vous n’êtes pas optimiste dans ce domaine, vous allez souffrir ! [Rires] Quand on parle d’explosion des coûts et du nombre de personnes atteintes d’ici 20 ans, c’est vraiment le pire scénario qu’on décrit. Moi, je suis plutôt optimiste et je pense que le nombre de personnes atteintes va diminuer. Peut-être que les coûts liés à la maladie vont malheureusement demeurer élevés, mais il est possible qu’on développe des solutions moins onéreuses, comme garder les gens à la maison en aidant les familles, par exemple.
Quelques mots sur « l’hypothèse amyloïde »
Pendant une vingtaine d’années, croyant qu’elle jouait un rôle déterminant dans le développement de l’Alzheimer, la recherche sur la maladie s’est presque exclusivement concentrée sur la protéine bêta-amyloïde. On pensait que c’était son accumulation entre les neurones du cerveau qui était à l’origine de la maladie. Au fil des ans, de nombreux médicaments censés empêcher cette protéine de s’accumuler ont été développés et testés, certains avec succès, sur des souris. Or, chaque essai sur l’être humain s’est soldé par un échec. Dans certaines études cliniques, relate le docteur Judes Poirier, les médicaments testés ont même accéléré la progression de la maladie. Un désastre.
Pourquoi un tel échec ? « L’Alzheimer, ça n’existe pas chez la souris », explique le Dr Poirier. Il a donc fallu implanter chez ces rongeurs des gènes liés à la maladie d’Alzheimer pour en provoquer l’apparition. Ces souris génétiquement modifiées auraient toutefois développé une forme rare de la maladie, qui ne représente qu’un à deux pour cent de tous les cas d’Alzheimer. Il s’agirait de la forme dite « jeune et agressive », ajoute le Dr Poirier. Celui-ci explique que le développement de la forme commune de la maladie, soit celle qui concerne environ 99 % de tous les patients, est influencé par des gènes différents que ceux impliqués dans le développement de l’Alzheimer de type jeune et agressif.
C’est donc parce qu’ils n’étaient pas atteints de la même forme de la maladie que les souris étudiées en laboratoire que les patients traités avec ces médicaments n’auraient pas vu leur condition s’améliorer.